Compréhension et expression écrites - Dr.TERRAS Imane-année universitaire2022/2023
Aperçu des semaines
-
-
Nom et prénom: Dr TERRAS Imane
Grade: MCA
e-mail professionnel: imane.terras@univ-saida.dz
Matière: Compréhension et expression écrites
Public cible: étudiants de la deuxième année licence de français
Crédit: 6, coefficient: 4
Volume horaire d'enseignement présentiel hebdomadaire: 3h.
Nombre de TD par semestre: 12
Mode d'évaluation: contrôle continu (50%), examen (50%)
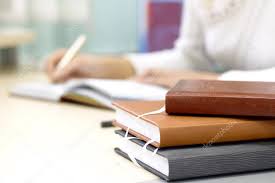
-
-
Semestre2: amener l’étudiant à :
-Maitriser quelques procédés linguistiques tels que la dénottaion et la connotation, les registres de langue, le statut du narrateur, le champ lexical.
-S'initier à la rédaction de: la dissertation, le commentaire composé, le compte rendu,l e questionnaire, l’essai argumenté, le CV et la lettre de motivation.
-
Premier semestre
-
-
Unité 1: Le schéma de la communication
-
Objectifs :
-Reconnaitre le schéma de la communication de Jacobson.
-Identifier les fonctions de la communication.
-
-
-
Unité 2: La typologie textuelle
-
Ce cours porte sur la notion de la typologie c’est-à-dire l’organisation des différents types et genres de textes courants et littéraires.
Objectifs :
-Distinguer entre la notion du genre et du type de texte.
-Identifier les caractéristiques linguistiques et discursives des types de texte.
-
-
-
Unité 3: Le texte explicatif
-
Objectif: reconnaître les caractéristiques du texte explicatif
-
-
-
Objectif du cours :
- Repérer les différents types de progression
-
-
-
-
-
Objectif:
-Rédiger un texte explicatif en respectant sa structure.
-
-
-
Objectif:
-corriger les différentes erreurs des étudiants concernant ce type d'écrit.
-
Ce chat porte sur les caractéristiques du texte explicatif déjà étudiés. Il contient des questions auxquelles vous devriez y répondre.
-
-
-
Unité 4: Le texte argumentatif
-
L’étude de textes argumentatifs occupe une place importante dans l'apprentissage de français à l'université . Cela semble tout à fait justifié, car il est essentiel de maîtriser l’argumentation avant d’entamer sa vie professionnelle. Cela permet de ne pas se laisser influencer de manière inconsciente par ceux qui maîtrisent l’argumentation.
-
-
-
Ce TD a pour objectifs de reconnaître les différentes étapes du développement et de la conclusion d'un texte argumentatif. De plus, quelques applications sont proposées aux étudiants pour identifier les différents articulateurs logiques qui organisent l'argumentation ainsi que les types de plan qui caractérisent ce type de texte.
-
Ce TD va porter sur l'étude de plusieurs textes argumentatifs. Il s'agit plus particulièrement de reconnaître la structure des textes argumentatifs (introduction, développement et conclusion).
-
Ce document contient une récapitulation de la structure de la lettre ouverte.
-
-
Ce TD a pour objectifs de reconnaître les différentes étapes du développement et de la conclusion d'un texte argumentatif. De plus, quelques applications sont proposées aux étudiants pour identifier les différents articulateurs logiques qui organisent l'argumentation ainsi que les types de plan qui caractérisent ce type de texte.
-
Ce TD va porter sur l'étude de plusieurs textes argumentatifs. Il s'agit plus particulièrement de reconnaître la structure des textes argumentatifs (introduction, développement et conclusion).
-
Ce document contient une récapitulation de la structure de la lettre ouverte.
-
-
-
-
Deuxième semestre
-
Ce TD est consacré à la classification des arguments sous différents types. Il a pour objectif d'aider les étudiants à identifier ces différents types d'arguments afin de les utiliser dans la rédaction des textes argumentatifs. Dans ce cours, seront traités les types d'arguments à savoir:
1. Argument logique ou pragmatique
2.Argument par la comparaison
3. Argument d’autorité
4. Argument par les valeurs
5. Argument de la norme
6. L’argument ad hominem
7. L’argument par l’analogie
-
Cette vidéo explicative aide les étudiants à comprendre les différents types d'arguments.
-
Ce chat est destiné aux étudiants du groupes 3, et 4 (deuxième année licence de français). Il permet de discuter sur les caractéristiques étudiés du texte argumentatif.
-
Ce wiki concerne les types d'arguments, il est destiné aux étudiants du groupe 3 et 4.
-
Ouvert : jeudi 16 février 2023, 18:00Terminé : jeudi 16 février 2023, 20:00
Ce test est destiné aux étudiants de la deuxième année licence de français.
-
-
-
Unité 5: Les écrits littéraires et professionnels
-
Ce TD porte sur une des techniques rédactionnelles, les plus utilisées , à savoir la dissertation. Il a pour objectifs d'initier les étudiants à la rédaction de ce type d'écrit tout en maîtrisant sa méthodologie . Dans ce TD, nous allons aborder les points suivants:
1-Définition de la dissertation
2.Types de la dissertation
3.Les étapes de la dissertation
4. Mise en forme de la dissertation
5.Application et correction
-
Cette vidéo est destinée aux étudiants de la deuxième année licence, qui sont appelés à maîtriser une technique rédactionnelle très présente dans leur cursus de formation.
-
Cet atelier est destiné aux étudiants de la deuxième année licence, groupes 3 et 4.
-
-
-
Ouvert le : jeudi 16 février 2023, 08:00À rendre : jeudi 16 février 2023, 22:30
Ce devoir est destiné aux étudiants de la deuxième année licence de français, groupes 3 et 4
-
-
-
L'objectif de ce TD est d'identifier les différentes figures de style. Ce Td est consacré aux points suivants: 1. -Définition des figures de style
-Types des figures de style
-Applications et correction
-
Cette vidéo vous explique davantage (avec des exemples) les différentes figures de style.
-
Ce chat a pour objectif de relever l' ambiguité sur les différents types de figures de style.
-
À terminer : dimanche 26 février 2023, 13:50
Ce forum a pour but de remédier aux lacunes des étudiants en leur proposant des activités sur les figures de style. Il s'agit de répondre aux questions posées.
-
Ce document contient des applications corrigées sur les figures de style.
-
-
-
Ce TD a pour objectif de reconnaître les trois points de vue du narrateur (focalisation) afin de se préparer à la technique du commentaire composé. Le plan de ce TD est:
1-Définition du statut du narrateur
2-Les types de focalisations
3-Application et correction
-
L'objectif de ce TD est d'amener les étudiants à identifier le champ lexical à partir de plusieurs textes. Le plan de ce TD est le suivant:
1.Qu’est-ce qu’un champ lexical :
2. Comment identifier un champ lexical ?
3.Du Champ lexical à l’idée
3.1. Comment identifier les sous thèmes
4.Application
-
Cette vidéo vous permet de mieux comprendre la notion du champ lexical avec des exemples concrets, elle contient également une application.
-
-
-
L'objectif de ce TD est d'identifier les différents registres de langue. Le plan du TD est le suivant:
1.Définition
2.Les types de registre de langue
3.Application
-
L'examen TD est programmé pour le 16.03.2023 aux mêmes horaires du TD et aux mêmes salles.
-
Ce wiki concerne les registres de langue, il est destiné aux étudiants du groupes 3 et 4.
-
-
-
Objectifs : - distinguer le sens dénoté du sens connoté.
- Illustrer les valeurs contextuelles qui peuvent influer sur le sens d’un mot.
Les points suivants seront abordés dans cette séance:
1.La dénotation : sens premier du mot
2.La connotation : les sens seconds d’un mot
2.1. Les types de connotation.
3.Applications
-
Ce wiki est destiné aux groupes 3 et 4, il porte sur la dénotation et la connotation.
-
-
-
Ouvert : jeudi 16 mars 2023, 19:00Terminé : jeudi 16 mars 2023, 20:30
L'examen en question est destiné aux étudiants du groupes 3 et 4, il comporte des questions de compréhension écrite.
-
-
-
Objectifs : 1-Initier les étudiants à la rédaction d’un commentaire composé à travers les points suivants :
a- Reconnaitre le statut du narrateur / la focalisation.
b-Reconnaitre les procédés stylistiques (les figures se style) .
c-Identifier les procédés lexicaux : champ lexical, le sens des mots (dénotation, connotation), les niveaux de langue.
2-Comprendre la technique du commentaire composé
Les points suivants seront traités dans ce TD:
1. Qu’est ce qu’un commentaire composé
2. Les étapes du commentaire composé
3.Application
3-Rédiger des commentaires composés.
-
-
-
Objectifs :
a-Maitriser la technique du compte rendu objectif.
b-Reconnaitre le plan du compte rendu objectif.
c-Différencier entre le résumé et le compte rendu objectif.
-
-
-
Objectifs :
a-Maitriser la technique du compte rendu critique.
b-Reconnaitre le plan du compte rendu critique.
c-Différencier entre le résumé et le compte rendu objectif et le compte rendu critique.
Les points suivants seront traités dans ce TD:
1-Définition :
2. Etapes pour la rédaction d’un compte rendu critique
3. Plan du compte rendu critique
4.Applications
-
-
-
Objectif : -Maitriser la technique de l’essai. Le plan du TD est le suivant:
1.Définition.
2. Les types d’essais :
3.Le plan de l’essai argumenté :
4.Applications
-
-
-
Objectifs : -reconnaître les types de questions.
-Savoir rédiger un questionnaire.
Le plan de ce TD est le suivant;
1. Définition
2. Les caractéristiques du questionnaire
3. La structure du questionnaire
4. Les types de questions :
5. Guide pour l’élaboration d’un questionnaire
6. Exploitation des données du questionnaire
7. Exemple d’un questionnaire
8.Applications :
-
-
-
-
Objectifs :
-Identifier la structure d’une lettre de motivation.
-Savoir rédiger une lettre de motivation.
le plan de ce TD est le suivant:
1.Définition d’une lettre de motivation
2. Objectifs d’une lettre de motivation
3.Types de lettres de motivation
4.Structure d’une lettre de motivation
6.Le corps de la lettre de motivation
7.La formule de politesse
8. Conseils méthodologies pour la rédaction de la lettre de motivation :
9. Modèles d’une lettre de motivation
10.Applications :
-
Objectifs :
-Maitriser la technique du CV et reconnaître son utilité.
-Identifier les différents types de CV.
-
cette activité est destiné aux étudiants du groupe 3 et 4. elle porte sur le CV.
-
-
-
Cette rubrique contient les principaux concepts à maitriser et qui sont liés à la matière du CEE.
